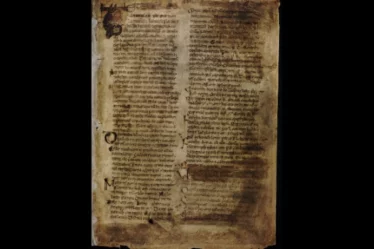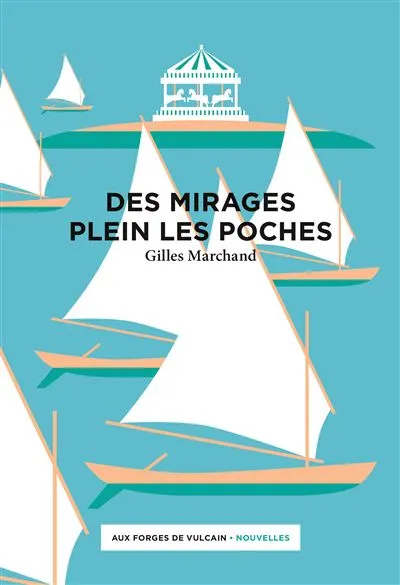
Des mirages plein les poches, recueil de nouvelles
Il est rappelé régulièrement ici et là que les lecteurs boudent les recueils de nouvelles, notamment parce que la brièveté (pourtant relative, parfois) des textes nuirait à l’immersion et à l’identification des personnages.
Le genre de la nouvelle semble présenter des enjeux esthétiques plus attirants pour les auteurs que pour un large lectorat, que l’on essaie le plus souvent de séduire par la cohérence thématique du recueil publié : c’est d’ailleurs le cas, avec le recueil Des mirages plein les poches de Gilles Marchand, publié Aux Forges de Vulcain (comme vous vous en doutez, il n’y aura donc aucune objectivité à attendre de cet article [1]).
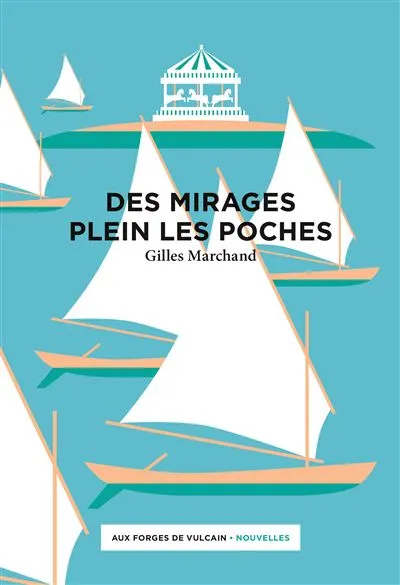
Suivre le fil
Ainsi le recueil évoque bien essentiellement des personnages aux prises avec leurs rêves, et les grosses déceptions et petites consolations que cela implique : l’auteur le rappelle lui-même dans une vidéo de présentation pour la librairie Mollat.
Mais à mon sens Gilles Marchand renforce cette cohérence par des choix narratifs et stylistiques marqués : utilisation systématique de la première personne, anonymat relatif du narrateur (à priori masculin), rareté des dialogues et fonction symbolique des objets contribuent à procurer au lecteur le sentiment d’une confession discontinue.
On pourrait presque parler de parabole, dans la mesure où l’évocation nostalgique du passé invite le lecteur à s’interroger sur son propre mode d’existence alors que le narrateur-personnage fournit chaque fois l’image d’une persévérance plus ou moins maladroite, plus ou moins irraisonnée.
Or celle-ci incite à l’empathie et à la compassion : on notera que de nombreuses questions rhétoriques (« Je peux bien faire ça pour mon fils, non ? ») ou au discours indirect libre (« Sinon quoi ? ») parsèment les nouvelles, notamment leurs conclusions, comme autant de façons de prendre à témoin le lecteur et lui permettre d’apporter sa réponse personnelle, son jugement, sa complicité.
Il ne s’agit pas de prêcher au sens strict, bien entendu, mais les miragesdu titre correspondent aussi bien aux illusions perdues qu’aux rêves utopiques (« maison de mes rêves », « le bout d’un rêve », « le décor de rêve »…), et chaque narrateur-personnage cherche à compléter, à remplir ses poches et sa vie d’êtres ou d’êtres-objets qu’il puisse regarder et lui rendre ses regards. Je cite trois extraits de trois nouvelles différentes :
J’avance avec mon chargement, tant bien que mal, attirant sur moi les regards des gens qui s’étonnent d’un rien.
Depuis qu’elle ne travaillait plus, elle regardait tout ce qui bougeait sur le petit écran, revendiquant son appartenance à la caste très prisée des ménagères de moins de cinquante ans.
Parce que dehors il faisait froid et que mon frigo était vide, parce que cela faisait longtemps que je n’avais pas surpris les regards complices que des musiciens s’échangeaient, que je n’avais pas vu une liste de chansons posées sur le sol ou une serviette roulée en boule sur un tom basse.

Cela pose nécessairement la question de l’individu face aux autres dans une société déséquilibrée, dans laquelle « On imagine mal Spartacus [2] inhaler de la Ventoline avant d’entrer dans l’arène ». Qu’il soit clochard, père dépassé, célébrité déchue ou doux rêveur, le narrateur-personnage de Gilles Marchand constate l’absence de (super-)héros et le triomphe de « l’aventure du capitalisme à portée de main ».
Les formulations affectives qui concernent les objets (« des chaussures qui courent vite », « C’était un petit bateau, pas grand-chose en apparence, mais le bout d’un rêve, c’est forcément un grand quelque chose »), la recherche de héros simples, dévoués (en particulier les figures féminines) et en tout cas la volonté déclarée changer quelque chose, du fil qui dépasse au monde entier, font déjà du recueil une tentative de réappropriation politique du langage.
Certains la taxeront probablement de romantique, d’idéaliste ou de naïve, voire, avec une nuance dédaigneuse, de poétique, mais le cynisme des réseaux sociaux a l’instantané d’un tweet, quand l’écriture demande du temps : gageons qu’on écrit plus obstinément avec un idéal. Les mirages font avancer de quelques pas de plus.
Suivre le rythme
Par ailleurs, même si cela peut paraître excessif, cette manière de concevoir le recueil de nouvelles me renvoie à un article assez ancien de Jean-Luc A. d’Asciano, que ce dernier m’a donné à lire alors que j’étais en pleine réflexion au sujet de François d’Assise, et dont voici un extrait en particulier :
La pièce artistique, objet unitaire dans l’atelier de l’artiste, objet unitaire une fois exposée hors du squat, ne peut être exposée seule à l’intérieur du squat. Placées à côté d’une consœur, elles deviennent un ensemble unique, une même œuvre. Et ce système se déploie à l’infini : un squat est une communauté qui n’engendre qu’une œuvre, qu’une unique sensation qui tient d’un choc des sens.
C’est sans doute une analogie fallacieuse de ma part, mais à côté du si institutionnel roman, un recueil tel que Des mirages plein les poches a quelque chose du squat dont l’ensemble procure une sensation unifiée, qui serait très différente de la lecture désordonnée ou sélective des nouvelles.

L’auteur a été musicien, d’ailleurs le thème est récurrent dans son œuvre et est indiqué dans plusieurs titres de nouvelles (Un café et une guitare, Désordre de Beatles, Rappel) : au fil des nouvelles divers objets deviennent des instruments auxquels les personnages s’attachent sur le modèle des musiciens, et il n’est peut-être pas vain de songer à un travail de composition musicale du recueil, avec ses renvois, ses échos, ses petites phrases musicales qui souvent ouvrent ou ferment les nouvelles sans craindre d’utiliser la répétition pour renforcer l’effet :
J’avais un bateau mais le bateau coulait.
J’ai été un Indien, j’ai été un cowboy, j’ai été shérif, trappeur, chercheur d’or, ermite, aventurier, mercenaire.
Il faisait froid et mon frigo était vide, il faisait froid et je n’avais nulle part où aller. [3]
On sait, depuis Proust et sa sonate de Vinteuil, à quel point la musique permet de revivre le temps perdu et donne l’impression de durée.
Il ne s’agit évidemment pas d’établir une comparaison, mais de remarquer que, là où d’autres auteurs tendent à varier leur style en fonction des nouvelles, le rythme des phrases de Gilles Marchand contribue à la cohérence du recueil, entre moments de pause, de lenteur ou d’accélération [4], et que le rythme semble pour l’auteur un moyen pertinent de revenir vers les autres et le monde :
Alors j’ai enfoncé mes mains dans l’eau. Pour le rythme. J’ai ramé. Lentement. La côte s’est rapprochée. Il y avait du monde.
Notes :
[1] Dans la mesure, où pour rappel, les Forges de Vulcain publient également l’auteur de ces lignes.
[2] Détail amusant (est-ce une coïncidence ?), les Forges de Vulcain ont publié un Spartacus, roman de Romain Ternaux.
[3] Je ne cite ici que des incipit, de nouvelles différentes donc, pour éviter de gâcher aux lecteurs sourcilleux les chutes de quelques nouvelles.
[4] La remarque vaut aussi pour les longueurs variables des nouvelles.