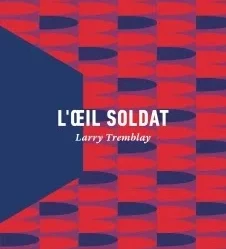Dans un précédent article, où on retrouvera le résumé du roman, j’ai évoqué à grands traits l’intertextualité présente dans le roman À crier dans les ruines d’Alexandra Koszelyk, publié aux éditions Aux Forges de Vulcain. Toujours en toute subjectivité (dans la mesure où je connais personnellement l’autrice et l’éditeur), voici à présent quelques réflexions sur les oeuvres qui sont non seulement mentionnées dans À crier dans les ruines, mais qui en plus ont la caractéristique d’être citées, et ce plus ou moins longuement.
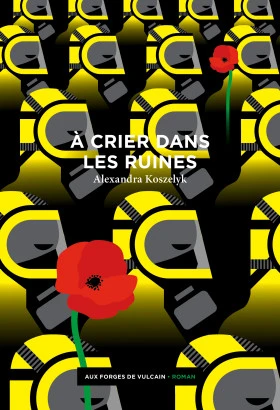
Droit de citer
Seules quelques œuvres en effet apparaissent sous la forme de citations. Elles sont chaque fois amenées par les lectures de Léna, grâce à un petit jeu de mise en abyme (le lecteur d’À crier dans les ruines suit les lectures d’un personnage !), et elles font logiquement écho aux émotions de la protagoniste. Les citations sont en tout cas révélatrices de son évolution, de ses moments de doute ou de prise de conscience.
Les auteurs russes
La première oeuvre, citée très tôt dans le récit (p.11), est tirée du roman Le Docteur Jivago de Boris Pasternak. Alexandra Koszelik choisit de retenir un bref passage de déclaration d’amour, du docteur à son aimée Lara (dont le prénom rappelle celui de Léna), dans la traduction de l’édition Gallimard.
Ma charmante, mon inoubliable ! Tant que le creux de mes bras se souviendra de toi, tant que tu seras encore sur mon épaule et sur mes lèvres, je serai avec toi.
La lecture de ce roman par Léna a une fonction symbolique suggérée dans le récit lui-même : en effet, si Le Docteur Jivago a paru en France dès 1957 (et encore, à l’époque les traducteurs ne furent pas mentionnés pour leur éviter l’hostilité de l’URSS !), il n’a été publié en Russie qu’en 1987, après la catastrophe de Tchernobyl.
En lisant le roman alors qu’elle est adulte et retourne en Ukraine pour la première fois depuis son enfance, Léna renvoie au fait qu’il ne lui était pas accessible lorsqu’elle était enfant et déjà grande lectrice. Une histoire d’amour lui était, littéralement, interdite. De façon comparable au docteur Jivago et Lara, c’est dans la séparation qu’elle aura dû vivre son amour pour l’Ukraine, et pour Ivan.

Autre roman russe, Anna Karénine (1877) de Tolstoï plaît suffisamment à Léna enfant pour qu’elle en punaise un extrait au-dessus de son lit (p.29) :
Les famille heureuses se ressemblent toutes, les familles malheureuses sont malheureuses chacune à leur façon.
Il s’agit de la première phrase du roman (dans la traduction d’Henri Mongault utilisée pour l’édition Gallimard, semble-t-il), qui peut certes renvoyer à la vie de famille de Léna, mais également à la « grande famille » que devait représenter le Parti Communiste en URSS, pour le malheur de beaucoup. On remarquera par ailleurs qu’Anna (autre prénom en « A » !) Karénine raconte les épreuves endurées par une femme isolée, voire exilée socialement à cause d’une histoire d’amour, ainsi que les déboires d’autres couples.
Troisième oeuvre russe citée p.81, Premier Amour (1860) de Tourgueniev est l’un des premiers livres que Léna lit en langue française lorsqu’elle arrive en France, justement, pour fuir Tchernobyl :
Sentiments timides, douce mélancolie, franchise et bonté d’une âme qui s’éprend, joie languide des premiers attendrissements de l’amour, où êtes-vous ?
Dans cette nouvelle (citée peut-être dans la traduction de Michel Rostislav Hofmann pour la collection « J’ai lu »), un adolescent de seize ans découvre toutes les cruautés d’un amour naissant. Il n’est pas innocent que Léna redécouvre ce texte alors qu’elle est elle-même adolescente en France.
On peut songer aussi au fait que Tourgueniev fait partie des écrivains russes « occidentalistes », qui considère que la Russie est inférieure aux pays européens, et qu’il vivra plusieurs années en France, où il mourra. Il peut donc représenter la tentation éprouvée par Léna de tourner le dos à son passé en URSS, ou du moins ses efforts pour trouver sa place en France.
Tragédie grecque et française
C’est l’Antigone de Sophocle qui occupe en apparence une place presque centrale (p.116) dans le roman. Léna découvre la pièce de théâtre par le biais d’un professeur de français et va jusqu’à jouer le rôle-titre dans le cadre du spectacle de fin d’année de son lycée. Suivant l’exemple d’Antigone, Léna s’affirme ainsi devant les autres, à la fois devant la société et devant sa famille (« elle s’adressa davantage à son père qu’au public » précise le roman) :
Antigone : Il faut que j’aille enterrer mon frère que ces hommes ont découvert.
Créon : Pourquoi fais-tu ce geste Pour les autres, pour ceux qui y croient ? Pour les dresser contre moi ?
Antigone : Non.
Créon : Ni pour les autres ni pour ton frère ? Pour qui alors ?
Antigone : Pour personne. Pour moi.
Il faut cependant noter que la citation, qui correspond au moment du spectacle, est tirée de la pièce du même titre de Jean Anouilh (éditions de la Table Ronde, 1946) qui est une variation de celle de Sophocle. Anouilh avait écrit (et fait jouer) sa pièce dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale, et Léna la joue alors que la guerre froide approche de son terme. Encore une fois, la grande Histoire et l’histoire individuelle se font écho (« elle se forgeait une histoire »).
La pièce est en tout cas l’occasion pour Léna de donner un sens plus spécifique à sa révolte adolescente et de se projeter encore davantage dans les personnages, en particulier féminins, de la littérature qu’elle aime. Qui plus est, la pièce met également en scène l’amour contrarié de deux jeunes gens, Antigone et Hémon, ce qui est cohérent avec les goûts de Léna.
Errances philosophiques
« L’étudiante ricochait d’histoire en histoire » nous apprend le roman, et Léna découvre L’Étranger de Camus dans la bibliothèque de son oncle (p.146). Le célèbre incipit est cité :
Aujourd’hui, maman est morte.
Brève citation, qui renvoie Léna à son éloignement familial (elle a quitté la Normandie pour étudier à Paris), à ses difficultés à communiquer avec sa mère, et à son sentiment d’exil. Camus est d’ailleurs qualifié « d’apatride » : on rappellera ici en quelques mots que l’écrivain est né en Algérie et a vécu comme un déchirement la guerre qui a opposé les nationalistes algériens à la France, et que mort en 1960 il n’aura pas vu la fin du conflit. En outre, L’Étranger est le versant romanesque de la philosophie de l’absurde de Camus, pour résumer : l’existence n’a pas de sens, mais l’homme désire lui en trouver un.
Lisant Camus vers le milieu des années 1990, Léna vit quant à elle les lendemains de l’effondrement de l’URSS et la crise des idéologies. Elle conserve un sentiment d’exil, trop absorbée par ses études et les découvertes de la jeunesse pour envisager de se rendre en Ukraine. De façon logique, les livres (« mondes de papier ») lui servent à la fois d’échappatoire et en quelque sorte de patrie de substitution, et lui fournissent temporairement les moyens de donner un sens à sa vie.

Cela explique entre autres raisons la fascination qu’exerce sur elle L’Insoutenable Légèreté de l’être de Milan Kundera, cité p.147 :
L’homme ne peut jamais savoir ce qu’il faut vouloir, car il n’a qu’une vie, et il ne peut ni la comparer à des vies antérieures ni la rectifier dans des vies ultérieures.
Milan Kundera, influencé par la philosophie de Nietzsche, formule à sa manière le concept d’éternel retour, soit très grossièrement : l’individu doit chercher à mener une vie qu’il serait prêt à répéter éternellement. En lisant Milan Kundera après Camus, Léna poursuit sa quête de sens.
De plus, Milan Kundera est lui aussi un écrivain exilé, puisqu’il a quitté sa Tchécoslovaquie natale où il subissait la censure du régime communiste. C’est donc encore un auteur qui montre comment la littérature donne du sens dans des contextes catastrophiques, un sens lié aux amours diverses de personnages confrontés à l’exil.
À cela s’ajoute la question de la langue : L’Insoutenable Légèreté de l’être a été écrit en tchèque en 1982 et traduit par François Kérel (pour l’édition Gallimard, 1984), or depuis Milan Kundera écrit en français et a revu entièrement les traductions françaises de ses oeuvres. À sa manière, et bien sûr dans le cadre fictionnel du roman, Léna a été confrontée aux besoins et aux difficultés de s’approprier le français, langue romane, alors qu’elle vient d’un pays de langue slave.
Ces lectures « philosophiques » se concluent avec une citation de Platon (p.147) tirée de l’Alcibiade majeur :
L’âme aussi, si elle veut se reconnaître, devra se regarder dans une âme.
Platon attribue cette phrase à son maître Socrate. Si je n’ai pas pu identifier la traduction, on pourra se reporter à celle de Maurice Croiset sur wikisource. L’Alcibiade majeur est un dialogue platonicien dans lequel Socrate fait la leçon au jeune Alcibiade, notamment par le célèbre « Connais-toi toi-même ». On peut souligner que la démarche de Socrate est motivé par l’amour qu’il porte à son interlocuteur, et que le texte de Platon inquiète Léna (« Quelle âme regardait-elle, elle ? »), renvoyée à ses propres insatisfactions et à son sentiment d’incomplétude depuis qu’elle a quitté l’Ukraine et Ivan.
Les épigraphes d’À crier dans les ruines
Faisons un cas à part des citations placées au début du roman, avant même que ne débute le récit.
La première (dont on trouvera une variante dans cette critique de Libération) provient d’un essai de Svetlana Alexievitch :
«Je me demande pourquoi on écrit si peu sur Tchernobyl. Pourquoi nos écrivains continuent-ils à parler de la guerre, des camps et se taisent sur cela ? Est-ce un hasard ? Je crois que si nous avions vaincu Tchernobyl, il y aurait plus de textes. Ou si nous l’avions compris. Mais nous ne savons pas comment tirer le sens de cette horreur. Nous n’en sommes pas capables. Car il est impossible de l’appliquer à notre expérience humaine ou à notre temps humain…»
Evgueni Alexandrovitch Brovkine, enseignant à l’université de Gomel, La Supplication – Tchernobyl, chroniques du monde après l’apocalypse, Svetlana Alexievitch
On rappellera simplement que Svetlana Alexievitch (ou Aleksievitch, semble-t-il), a obtenu le prix Nobel de littérature en 2015, qu’elle-même est née en Ukraine et vit aujourd’hui en Biélorussie, où elle critique entre autres les politiques menées par Alexandre Loukachenko et Vladimir Poutine. L’essai cité par Alexandra Koszelyk date de 1997, et il a été publié en France aux éditions Jean-Claude Lattès en 1999, dans une traduction de Galia Ackerman et Pierre Lorrain. Elle y rapporte des centaines de témoignages de témoin de la catastrophe de Tchernobyl, et on ne peut pas douter qu’il a été une source essentielle dans l’écriture du roman d’Alexandra Koszelyk.
On peut relever, aussi, ce qu’a de frappant la citation. D’une part elle est due à un enseignant, or Alexandra Koszelyk est professeur en collège et donne une image positive de l’enseignement dans son roman. D’autre part elle constitue en quelque sorte une invitation à l’écriture sur le sujet de Tchernobyl, au moment d’ailleurs où une série télévisée de 2019 du même nom a contribué à représenter la catastrophe pour un large public.
Quoi qu’il en soit, le roman À crier dans les ruines peut donc être lu comme une tentative de réponse à l’interrogation de l’universitaire ukrainien, tout en aboutissant à une conclusion comparable : Tchernobyl n’a pas été vaincu, ni compris, et la littérature ne saurait être l’instrument suffisant pour réparer un tel désastre. « Il est des images qu’on garde à l’abri, dans le creux de nos cicatrices » fait dire l’autrice à un de ses personnages : la littérature et la culture au sens large (y compris dans sa dimension orale, celle du conteur par exemple) est ici présentée comme un moyen de témoigner, et qui accompagne les témoignages déjà formulés par d’autres. Cette épigraphe renvoie donc surtout à la dimension historique abordée dans le roman.

La deuxième quant à elle est extraite d’un roman, Les Hauts de Hurle-Vent d’Emily Brontë, et renvoie à la dimension amoureuse :
Si tout le reste périssait et que lui demeurât, je continuerais d’exister ; mais si tout le reste demeurait et que lui fût anéanti, l’univers me deviendrait complètement étranger, je n’aurais plus l’air d’en faire partie.
Cette phrase est extraite d’un moment important du roman, lorsque Catherine Earnshaw avoue à la narratrice Nelly Dean les sentiments qu’elle éprouve pour Heathcliff, personnage au minimum ambigu, voire franchement démoniaque. Mais Heathcliff, ignorant ce que Catherine ressent pour lui, s’éloigne d’elle pendant quelques années pour revenir riche et cruel. La citation renvoie donc à un amour maudit, marqué par la distance et les malentendus. Il renvoie également à une dimension fantastique, puisque le roman de Brontë suggère que Catherine et Heathcliff deviendront un couple de fantômes.
Sans trop en dire sur le roman Alexandra Koszelyk, on peut formuler l’hypothèse que le couple formé par Léna et Ivan se veut un reflet du couple de Brontë, de la même façon que le « crier » du titre de l’un peut faire écho au « Hurle » de l’autre. On notera ainsi que les références au vent dans À crier dans les ruines sont associées le plus souvent à un chant positif issu de la nature personnifiée. Par exemple : « Elle chantait les retrouvailles de deux enfants choisis et réveillait ses cordes de vent. » Après le vent hurleur du roman de Brontë, Alexandra Koszelyk proposerait donc le lyrisme d’un monde réenchanté [1].
[1] On nuancera le propos en rappelant que le roman de Brontë finit sur une promesse de paix.