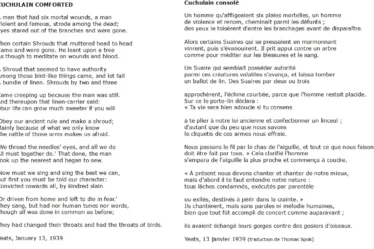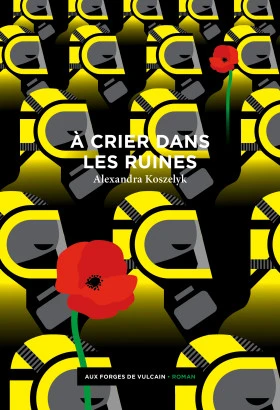
À crier dans les ruines d’Alexandra Koszelyk est le roman français de la « rentrée littéraire 2019 » des éditions Aux Forges de Vulcain, roman finaliste du prix Stanislas et sélection Jeunes Talents 2019 des librairies Cultura. Dans la mesure où l’auteur de ces lignes est lui-même affilié aux Forges, les quelques réflexions suivantes ne peuvent prétendre à aucune objectivité, d’autant que j’ai eu plus d’une fois l’occasion d’échanger avec l’autrice.
À crier dans les ruines d’Alexandra Koszelyk, Léna et l’amour de la littérature
J’évoquerai dans un premier article l’intertextualité abondante du roman, d’abord d’une façon assez générale, avant de proposer quelques pistes plus spécifiques dans un deuxième article.
Résumé de l’éditeur
Tchernobyl, 1986. Lena et Ivan sont deux adolescents qui s’aiment. Ils vivent dans un pays merveilleux, entre une modernité triomphante et une nature bienveillante. C’est alors qu’un incendie, dans la centrale nucléaire, bouleverse leur destin. Les deux amoureux sont séparés. Lena part avec sa famille en France, convaincue qu’Ivan est mort. Ivan, de son côté, ne peut s’éloigner de la zone, de sa terre qui, même sacrifiée, reste le pays de ses ancêtres. Il attend le retour de sa bien-aimée. Lena grandit dans un pays qui n’est pas le sien. Elle s’efforce d’oublier. Un jour, tout ce qui est enfoui remonte, revient, et elle part retrouver ce qu’elle a quitté vingt ans plus tôt.
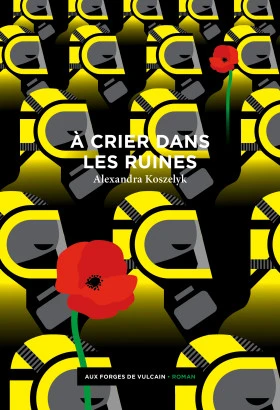
De l’école à la Sorbonne, de Paris à Kiev en passant par l’Italie, le personnage de Léna est fasciné par les histoires sous toutes leurs formes, écrites ou orales. Ces histoires lui permettent peu à peu de composer la sienne en écho à l’Histoire dont elle est témoin, et dont les jalons les plus retentissants sont la catastrophe de Tchernobyl le 26 avril 1986, la chute du mur de Berlin le 9 novembre 1989 et l’effondrement du bloc soviétique en 1991.
Relever les oeuvres mentionnées par Alexandra Koszelyk, toujours en association avec Léna, c’est donc refaire avec elle le parcours d’une éducation et d’une psychologie, ainsi que constater comment l’intertextualité produit des effets d’échos et de renvois qui poursuivent, au-delà même du roman, la quête de sens que partage le lecteur avec la protagoniste.
La grande librairie de Léna
On peut d’ailleurs constater que le rapport à l’enseignement et à la littérature est toujours essentiellement positif dans le roman, notamment parce qu’il est une façon pour Léna d’accepter son exil (« Plus elle lisait, plus elle devenait française. »). Il montre aussi comment le personnage s’éloigne en apparence de la littérature russe (imposée par l’URSS en Ukraine) pour s’imprégner de la culture occidentale, au point de créer une impression de dédoublement : « Elle avait travaillé, parlé et lu en français, mais ses pensées et ses rêves se faisaient toujours dans sa langue natale. »
Ce sont en effet les œuvres russes qui sont mentionnées au début du roman, alors que Léna et son amoureux Ivan, adolescents, en discutent avec passion. C’est le temps de l’innocence, l’usine de Tchernobyl est intacte.
Anna Karénine de Tolstoï est un des romans favoris de la jeune Léna, annonçant déjà de futurs troubles familiaux. Gogol (né en Ukraine !) en particulier est nommé pour ses nouvelles, dont Le Journal d’un fou, et son roman Les Âmes mortes qui prêtent d’abord à des débats moraux, et au constat que les beaux livres et la nature sont des plaisirs indépassables.
Une fois adulte, cependant, Léna de retour dans la région de Tchernobyl donnera un sens plus sinistre aux Âmes mortes, à la fois rappel des morts dans la catastrophe et des souffrances de « l’âme slave », incarnées par les veuves qui reviennent régulièrement sur les lieux de la catastrophe.
Premier amour de Tourgueniev est le roman de la transition entre Ukraine et France, lorsque Léna s’appuie sur sa connaissance du texte russe pour lire le roman en français.
De façon toute symbolique, deux autres romans russes sont évoqués uniquement quand Léna est en Ukraine : Le Docteur Jivago de Pasternak et Le Pavillon des cancéreux de Soljenitsyne [1]. Ce sont les romans du retour, donc, et des romans où l’amour joue un rôle aussi majeur que douloureux.

French touch : Léna et la culture occidentale
En France, par contraste, Léna délaisse rapidement les russes au profit principalement de la littérature française, et dans une moindre mesure grecque et anglaise. Certaines références sont discrètes, évoquées comme en passant, suggérant qu’elles sont devenues tellement naturelles pour Léna qu’elles se confondent avec sa perception du monde. Par exemple, certains auteurs ont droit à une mention sans développement particulier : Pagnol et Giono sont nommés sans être attachés à un livre précis, tandis que le titre du Petit Prince est donné sans son auteur Saint-Exupéry.
Les Fables de La Fontaine ne sont suggérées que par une tournure (« le lièvre dans la fable »), de même que Les Voyages de Gulliver de Swift (« Léna s’imbriqua dans ce lieu comme le géant de Gulliver chez les Lilliputiens »), ou Les Aventures d’Alice au pays des merveilles de Carroll (« Elle imaginait alors avoir bu un peu trop de cette potion qui faisait rapetisser Alice. »). La littérature semble alors se superposer à la réalité à la moindre occasion.
Perrault n’est jamais nommé comme auteur des Contes de ma mère l’Oye, mais « Barbe Bleue » ou « le Petit Poucet » font partie des lectures de Léna qui ne les associe pas spécifiquement à l’enfance (les cailloux du Petit Poucet sont ainsi assimilés aux livres qui aident Léna à se retrouver). La lecture est en effet toujours présentée comme un plaisir, sans souci de hiérarchie [2].
Parmi les lectures de lycéenne et d’étudiante de Léna se trouvent donc aussi bien des contes (Contes et légendes du Cotentin, qui font découvrir un premier frisson d’érotisme), de la science-fiction (La Nuit des temps de Barjavel), des pièces de théâtre (Le Jeu de l’amour et du hasard de Marivaux, Antigone de Sophocle et d’Anouilh), de la philosophie (Le Banquet et Alcibiade de Platon). Tous les genres sont abordés, les programmes scolaires suscitant ici la passion plutôt que le rejet, les lectures individuelles prenant le relais.
L’amour bien sûr est un fil conducteur, qu’il soit ou non tragique : Une vieille maîtresse de Barbey d’Aurevilly (évoqué par l’allusion à la fée « milloraine ») raconte une histoire d’amour brisé, L’Insoutenable Légèreté de l’être de Milan Kundera expose différentes conceptions de l’amour, Les Hauts de Hurle-Vent d’Emily Brontë lient amour et cruauté.
On ajoutera encore à ces textes Le Songe de Poliphile, roman italien de 1467 célèbre pour ses illustrations, qui mélange italien, latin et grec pour faire le récit du voyage onirique de Poliphile pour retrouver son aimée Polia.

Carte du tendre : la mémoire et l’exil
Un jeu s’esquisse avec le lecteur, amené à confronter ses propres lectures scolaires (ou non) à celles du personnage, et encouragé à se les approprier à son tour ne serait-ce que pour mieux s’identifier à Léna. Elle-même se projette, la sonorité des prénoms aidant, dans Lara du Docteur Jivago ou Eléa de La Nuit des temps, mais aussi dans Antigone (elle veut être une Antigone blonde). Les histoires d’amour se confondent finalement avec l’amour de la littérature et le désir/besoin d’être complété, éventuellement de prendre place dans la société, dans un collectif.
Ce besoin transparaît dans les oeuvres de Camus citées dans le roman, L’Étranger ou L’Exil et le Royaume, mais aussi dans l’intérêt que Léna montre pour certains essais : Paris photographié au temps d’Haussmann (par Charles Marville) ou L’Esthétique de la ruine (inspiré par Esthétique des ruines : poïétique de la destruction).

De ce point de vue les ruines ne sont plus tant la marque d’une destruction irréversible qu’un héritage à revendiquer, des vestiges dont la littérature porte témoignage. Elles font en fait une géographie de la mémoire collective, qui superpose souvenirs et fantasmes au paysage de la catastrophe.
Le roman l’explicite, par le point de vue de Léna :
elle se forgeait une histoire, faite de légendes ukrainiennes de sa grand-mère, de mythes grecs de son professeur de lettres, et d’ondes celtes de son amie. Le puzzle de Léna se complétait. Quelques pièces manquaient encore.
ou par celui de sa grand-mère Zenka :
De l’Ukraine je ne voulais pas garder l’effroi des dernières heures. Alors je l’ai enfanté d’une nouvelle mythologie. Je n’ai cessé de broder de nouvelles histoires en te les racontant soir après soir. Au fil des pages de mon livre imaginaire, l’Ukraine s’est effacée au profit de ces nouvelles couleurs que je t’avais transmises.
La lecture (ou l’écoute d’un conteur) devient une re-création de la réalité vécue et parfois perdue. La littérature accompagne le passage de Léna de l’enfance à l’adolescence puis à l’âge adulte, mais aussi d’une époque et d’un pays à l’autre, et les références aux œuvres sont utilisées de façon à imager le rapport du personnage à l’existence, comme si à tout moment un personnage, une référence, jaillissait pour expliquer le monde.

Un poème et une cicatrice : le titre du roman
Le titre « À crier dans les ruines » (dont la légende rapporte qu’il a été soufflé par l’auteur Gilles Marchand) peut donc être lu comme cette invitation toute orphique de la descente aux Enfers et du deuil (des morts, du passé…) et de la responsabilité de témoignage qui incombent à ceux qui en remontent. Cela peut concerner aussi bien ceux qui sont restés en Ukraine que ceux qui l’ont quittée : « La mémoire porte ses cicatrices, l’exil faisait partie des miennes » déclare Zenka dans le roman.
Dans le roman, cette responsabilité pesante revient surtout aux « samossiols », les « revenants », sans doute plus conscients que d’autres de leur mortalité. Ce sont en particulier les veuves des hommes partis éteindre le feu dans la centrale de Tchernobyl le jour de la catastrophe, à qui le gouvernement a refusé des explications, et donc un minimum de reconnaissance et de sens.
À ce qui a été perdu, elles opposent « leurs chants ancestraux, vain pansement », et « Chacune porte un masque pour cacher leur réalité, comme dans les tragédies », chacune acceptant ainsi le poids du deuil commun.
On constatera à quel point le titre du roman d’Alexandra Koszelyk résume les tensions des histoires individuelles et collectives : il est tiré du « Poème à crier dans les ruines » (extrait du recueil La Grande Gaîté, 1929) de Louis Aragon, poème d’amour douloureux adressé à sa maîtresse de l’époque, Nancy Cunard.
S’il s’agit d’un recueil de jeunesse, on n’omettra pas pour autant de songer qu’Aragon vécut deux Guerres mondiales et eut une histoire d’amour célèbre avec Elsa Triolet, elle-même expatriée russe : certaines vies paraissent plus que d’autres romanesques.
Il fut, aussi, le chantre du communisme et de l’URSS, dont il condamna par la suite la terreur, tout en restant membre du Parti Communiste Français. Qui plus est, mort en 1982, il ne fut pas témoin de Tchernobyl. Associer son poème à un roman sur la catastrophe est une façon de le réactualiser, bien sûr, et de faire du roman au moins un écho du poème, par-delà les années écoulées.
Notes :
[1] Léger divulgâchis : Le Pavillon des cancéreux de Soljenitsyne constitue un cas particulier dans le roman puisque c’est Ivan qui y fait référence. Il y a appris que le thé d’écorce de bouleau aurait des effets bénéfiques contre le cancer en Sibérie, et il a décidé d’en planter dans la région de Tchernobyl. Dans la logique de cette référence, le roman de Soljenitsyne aurait une influence sur la « réalité » d’Ivan. On peut aussi remarquer que dans Le Pavillon des cancéreux, le personnage Kostoglotov renonce à la femme qu’il aime pour lui éviter une vie décevante. Ivan ressent la même tentation.
[2] Seule exception : La Bicyclette bleue de Régine Desforges, publié en 1981 et énorme succès de l’époque, est considéré par Léna comme de la « mièvrerie ».