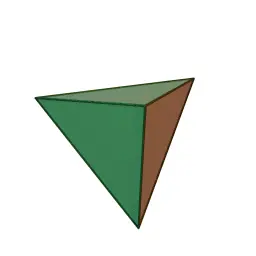
Nous sommes tous platoniciens. Et c’est par la porte de derrière que Platon s’est immiscé en nous, à notre insu pour ainsi dire, et qu’il a déposé là, dans nos consciences, le germe d’une curieuse injure. « Sophiste ! » dit-on à l’endroit de qui prostitue le langage pour violer la vérité. « Sophiste ! » est avant tout le cri d’une indignation intellectuelle. À raison ou selon la raison de Platon ?
Sagesse des sophistes
Pourtant, l’étymologie nous rappelle la proximité du cousinage entre les vrais sages et les pirates de la langue. Ainsi, le philosophe est celui qui « aime la sagesse », là où le sophiste est un « spécialiste de la sagesse ». Platon a, pour nous, séparé le bon grain de l’ivraie. C’était au IVe siècle av. J.-C. à la suite (ou à la place ?) de Socrate, le philosophe s’évertua à détruire le crédit d’une école rivale de son académie, non sans un certain art, puisque Protagoras ou Gorgias, les principaux sophistes de l’époque, ont été absolument emmerdés, au sens premier. Ce billet est donc une invitation. Une invitation à remuer la fange multimillénaire qui recouvre une pensée digne d’intérêt.
Qu’est-ce que la sophistique ?
La sophistique est d’abord une rhétorique, c’est-à-dire un art oratoire dont les effets peuvent être entendus par la science. Il nous faut donc considérer que les sophistes sont des « experts » de la langue, des mots, et surtout de leur utilisation orale. Or, les mots sont des créations humaines pour désigner des choses, mais le fonctionnement du langage force à constater l’existence d’un hiatus entre ces mots et les choses puisque les mots ne sont jamais totalement adéquats avec les choses. Il se peut, par exemple, que les mots que j’utilise aient plusieurs sens, que l’intonation que je leur donne leur confère une force ou une faiblesse supplémentaire ou que la construction de ma phrase soit équivoque. Alors concluons dès à présent que les mots et les choses fonctionnent sur des modes différents.
C’est l’idée des sophistes : traiter séparément (et uniquement) le monde des mots, sans tenir compte du monde réel, physique. Ainsi, si je soutiens un raisonnement absurde, mais vrai quant aux prémisses posées, alors mon raisonnement est valable.
Exemple type de sophisme :
Prémisse majeure : « Tout ce qui est rare est cher, »
Prémisse mineure : « Un cheval bon marché est rare, »
Conclusion : « Donc un cheval bon marché est cher »
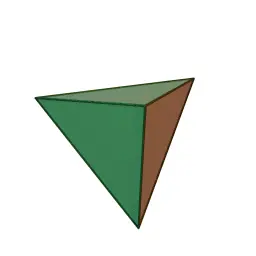
Le raisonnement est valable puisqu’il est logiquement sans faille. Pourtant, il ne correspond pas à la vérité. En déliant ainsi le monde des mots aux choses, les sophistes vont ainsi proposer une technique de discours raisonné qui n’est finalement qu’un auxiliaire d’une utilité purement pratique (convaincre), foulant aux pieds toute éthique, justice, vérité. Ceci compris, nous ne pouvons, à ce stade, que rejoindre Platon : les sophistes sont des fripons [1].
Oui mais…
Si nous acceptons le postulat sophiste sur le langage, alors un continent entier de la pensée s’offre à nous. Voici ci-dessous, quelques explorations, principalement aux côtés de Protagoras (-490/-420), Gorgias (-480/-375) et d’Antiphon (-480/-410), mais aussi des philosophes sceptiques comme Pyrrhon (-365/-275).
Protagoras et Gorgias, premiers penseurs de la sophistique
Protagoras est la vedette pensante du mouvement sophiste, mais il nous est surtout connu par l’intermédiaire de Platon (bon…), notamment dans le Théétête ou plus simplement dans le dialogue qui porte son nom : le Protagoras. La citation la plus célèbre de Protagoras, rapportée par Platon dans le Théétête, est la suivante : « l’homme est la mesure de toute chose » [2].
Protagoras semble ainsi nier toute possibilité d’établir une science (hormis celle des mots « bien liés ») puisque toutes les choses sont relatives à celui qui les perçoit. Ainsi, telle chose peut paraître épicée à tel homme, tandis que tel autre la trouve fade. Toute connaissance objective et absolue est donc impossible, puisqu’en dernière instance, c’est l’homme qui établit les choses, notamment par le moyen de mots. Nous ne pouvons ainsi que connaître des choses relativement et non absolument. Donc l’éthique, la justice et la vérité ne sont pas des choses absolues, mais relatives. Alors il est inutile d’en faire cas lorsque l’on use de son discours pour convaincre.

Plus il y a de trous, moins il y a d’emmental.
Donc plus il y a d’emmental, moins il y a d’emmental » CQFD
Pour convaincre, le sophiste, parce qu’il est avant tout un rhéteur, doit avant tout s’entraîner à défendre des thèses contradictoires. Toute thèse, disent les sophistes, possède son contraire et ce contraire peut-être étayé par des arguments aussi solidement que la thèse initiale. La langue devient alors une sorte de jeu intellectuel qu’il convient de résoudre comme une résoudrait une équation mathématique. Le jeu est réussi lorsque les arguments pour et contre se neutralisent (on se rapproche de la méthode de la dissertation). Le sophiste habile peut alors défendre n’importe qui et n’importe quoi, tout à la fois dans les discussions libres de banquets (qui n’engagent à rien), mais aussi dans les affaires de la cité.
Le relativisme préexistant à Protagoras (celui d’Héraclite disant que « les ânes préfèrent le foin à l’or » [3] ou de Xénophane disant que « Si les chevaux avaient des mains, ils peindraient des figures de dieux semblables à des chevaux » [4]) est ainsi institué comme un mode d’être dans la cité. Le relativisme « social » est né.
Gorgias, l’autre grand sophiste, contemporain de Protagoras, établit les choses plus clairement encore en posant trois propositions qu’il juge inattaquables [5] :
- Rien n’existe car… (on respire) : l’Être (le « quelque chose ») ne peut venir du Non-Être (le « rien ») puisqu’il est absurde de voir quelque chose surgir du néant (Coucou Big Bang). Alors, il faut en conclure, avec Parménide [6], que l’Être est éternel (il a toujours existé). Mais, « Si l’Être est éternel, il est illimité ; s’il est illimité, il n’est nulle part ; s’il est nulle part, il n’est pas. » Donc l’Être ne peut pas être éternel. Alors s’il n’est pas éternel ni engendré, il n’est rien. Donc l’Être n’existe pas. Voilà, maintenant vous avez de l’huile essentielle de sophistique dans les yeux.
- Quand bien même il existerait quelque chose, les hommes ne peuvent pas en avoir une connaissance absolue (puisque toute connaissance est relative, ainsi que nous l’avons vu avec Protagoras). La connaissance serait donc impossible.
- Quand bien même cette connaissance absolue serait possible, il serait en revanche impossible d’en faire état par le langage, puisque les mots ne sont pas le réel. La connaissance serait ainsi informulable.
Tranquillement, Gorgias vient de poser les conditions d’un nihilisme absolu. Super.
Parvenu à cet état de votre lecture, vous penserez sans doute que la sophistique est encore plus détestable qu’avant votre lecture. Certes. Mais allons plus loin encore, avec Antiphon.
Antiphon ou comment vivre en sophiste
Sophiste athénien du Ve siècle, Antiphon pousse plus loin la logique sophiste. Ainsi, puisque nous avons admis que l’éthique, la justice et la vérité sont des choses relatives, alors nous devons considérer, avec Antiphon, que ce sont des conventions, c’est-à-dire des axiomes pratiques que les hommes ont établis arbitrairement. Or, ces conventions appartiennent à l’opinion, au Non-Être (c’est-à-dire qu’elles n’existent pas vraiment) quand la Nature seule est vraiment, quoi qu’en dise Gorgias.
Ainsi les lois qui nous gouvernent sont des conventions artificielles. Nous progressons. Antiphon constate que souvent ces lois contraignent la Nature, c’est-à-dire que le Non-Être contrarie l’Être, ce qui est absurde. Or, notre seule inclinaison doit être de suivre la pente que nous donne la Nature (coucou Spinoza). Donc il est possible, dans le plus grand des calmes, d’outrepasser la loi [7].
Mais plus encore, il est aussi possible de « jouer » avec les autres conventions, par exemple les mœurs : la famille et les rapports moraux qu’elle implique est ainsi une convention. Alors il est possible, toujours aussi calmement, d’user avec elle, de rapports très libéraux. Le mieux étant de ne pas en avoir du tout [8].
En ayant admis ceci, il est peu probable qu’Antiphon vous paraisse plus sympathique que Protagoras. Pourtant, par le truchement de ce tour de passe-passe métaphysique, Antiphon ouvre ici un abîme de possibilités. Reprenons : si tout est convention, et si les conventions ne sont rien pour moi, alors il m’est possible d’exercer une liberté absolue sur tout : je peux agir absolument comme je le désire, sans nulle contrainte arbitraire et conventionnelle, avec toutefois comme seul commandement le fait d’agir conformément à ma nature. Antiphon libertaire. Antiphon agréable. Antiphon sympa.
Antiphon médecin aussi. Jugez ainsi. Puisque nous avons admis, en sophiste, que le monde des mots et que le monde des choses sont deux ensembles séparés, mais qui entretiennent des relations entre eux (c’est une évidence, puisque les mots sont comme fixés aux choses qu’elles désignent), il faut alors entendre que l’expérience des choses se traduit dans notre esprit par des mots… mais aussi que les mots s’échappent et exercent un pouvoir sur les choses. Comment ?
Antiphon découvre que les hommes sont parfois « malades des mots », c’est-à-dire qu’il existe des maladies de l’âme (produits justement par le hiatus qu’il existe entre les conventions crées par les humains et leur nature propre). Jugeons alors que les mots sont capables de produire des effets sur les corps. D’un autre côté, « l’effet placebo » montre la puissance d’une idée (et donc des mots) sur les choses, dans un mouvement inverse. Antiphon en vient à la conclusion qu’il est possible de « guérir par le discours » [9]. Antiphon psy.
Ainsi, nous commençons à entrevoir que la sophistique peut mener tout à la fois à une éthique libertaire, mais aussi à une certaine hygiène mentale. Avançons encore plus dans notre exploration avec Pyrrhon.
Pyrrhon et le scepticisme : le stade terminal de la sophistique ?
Pyrrhon n’est pas un sophiste, mais un philosophe sceptique. Cependant, le lien de filiation semble assez net pour que nous choisissions de le faire figurer ici. Le scepticisme pyrrhonien consiste principalement dans l’idée de douter de tout (des conventions ET de la nature) et de se complaire dans le doute. Ainsi, le sage sceptique atteint l’ataraxie (le bonheur en tant qu’absence de douleur) en suspendant son assentiment, c’est-à-dire en choisissant de ne pas choisir [10]. Or, cet état de suspension de l’assentiment (épochê) est atteint par l’intermède de la sophistique.
Puisque nous avons établi que les sophistes, avec Protagoras, pour tout sujet, visent à neutraliser les arguments contraires en les opposant, de manière à atteindre un « équilibre argumentaire », il est évident que c’est précisément cet équilibre absolu qui va servir de moyen pour les sceptiques de suspendre leur assentiment. Plus clairement, j’envisage les arguments, je les égalise de manière à me tenir en équilibre au-dessus d’eux, et je reste là, perché, et je suis content. Je suis content parce que je domine les passions humaines. Alors je regarde les hommes se passionner jusqu’à cramoisir, tandis que je reste tranquille, suspendu.

Ainsi, la sagesse selon Pyrrhon consiste à refuser de donner son assentiment à un dogme. Or, tout dogme admet et veut faire admettre une vérité. Ainsi, le refus d’établir des vérités que l’on trouvait chez Protagoras prend ici une allure nouvelle, puisqu’elle permet d’atteindre le bonheur. Mais, si le moyen d’atteindre le bonheur existe et qu’il consiste à douter, alors nous tenons là une vérité que nous pouvons, en sceptique scrupuleux, à nouveau soumettre au doute. Pyrrhon divise par zéro.
Ainsi Pyrrhon, poussant le système sceptique à son extrême limite, finissait par douter des choses les plus élémentaires : « il était conséquent (avec ses principes) jusque par sa vie, ne se détournant de rien <lorsque des choses se présentaient sur son chemin> […] : voitures, à l’occasion, précipices, chiens, et toutes choses de ce genre, ne s’en remettant en rien à ses sensations. Il se tirait cependant d’affaire, à ce que dit Antigone de Caryste, grâce à ses familiers qui l’accompagnaient [11] » rapporte ainsi Diogène Laërce. D’autres sages sceptiques, conscients du problème, choisirent d’arrêter le doute quelque part. Mais poser un « où » est justement un « arrêt dogmatique », c’est-à-dire une sortie du scepticisme. Le problème reste ainsi à résoudre.
On le voit ici, la méthode sophistique a lien avec le relativisme (Protagoras) participe à une position philosophique proposant le bonheur, la liberté et la tranquillité (Antiphon et Pyrrhon), sur un mode proche des spiritualités orientales (bouddhisme, taoïsme), alors que nous tenions pour certain, par l’intermède de Platon, qu’il ne s’agissait initialement que pur charlatanisme.
C’est peut-être en soumettant cette idée que nous achevons notre exploration : il existe une eudémonologie (c’est-à-dire un « art du bonheur ») sceptique (donc sophiste) dont la matière, encore aujourd’hui mal dégrossie, ne demande qu’à être défrichée et explorée plus en avant.
R.Barbier
Notes :
[1] C’est la thèse énoncée par Platon dans Le Sophiste, Flammarion, Paris, 2006
[2] Platon, Parménide, Théétête, Le Sophiste, Gallimard, Paris, 1992, p. 73.
[3] Héraclite, Fragments, Flammarion, Paris, 2004, p. 94.
[4] Les auteurs grecs avant Socrate, Flammarion, Paris, 1964, p. 60.
[5] La thèse de Gorgias est connue par l’intermédiaire de Sextus Empiricus, Contre les mathématiciens, VII.
[6] Parménide établit que « l’Être est et le Non-Être n’est pas » dans Sur la Nature ou sur l’étant, Seuil, Paris, 1998.
[7] Antiphon le Sophiste, Fragments, Les Belles Lettres, Paris, 2002, p. 178.
[8] Antiphon le Sophiste, Fragments, Les Belles Lettres, Paris, 2002, p. 182.
[9] Plutarque, Vie des orateurs, « Antiphon », Les Belles Lettres, Paris, 1923.
[10] C’est la thèse exposée par Sextus Empiricus dans les Esquisses pyrrhoniennes, Seuil, Paris, 1997.
[11] Diogène Laërce, Vie et doctrines des philosophes illustres, Livre XI, « Pyrrhon », LGF, Paris, 1999, p. 1100.



les présupposés épistémologiques de la dialectique socratique sont fondamentalement différents de ceux employés par les sophistes : en ce sens, si le philosophe se sert de la réfutation comme un
moyen de purifier l’opinion fausse de son interlocuteur, tel le sophiste ; son objectif et les présupposés qui le fondent sont différents.
Ainsi, pour le philosophe, le savoir ou la science du monde des Idées s’originent dans l’agent de la connaissance lui-même, moyennant une réminiscence ou anamnèse qui n’est possible que par la maïeutique du philosophe instaurée dans la relation de maitre à disciple.
En ce sens, la vérité est immanente au disciple lui-même, selon un redéploiement dialectique des vérités qu’il « contient » en puissance.
Il n’y a donc pas d’extériorité du savoir par rapport à lui-même, ni même de séparation entre le monde sensible et le monde intelligible.
Dès lors, le statut de la réfutation dialectique se révèle différent de celui de la réfutation sophistique : en effet, la réfutation dialectique est une propédeutique à la science dialectique, moyennant la correction d’une opinion fausse, afin de disposer l’âme au dévoilement des vérités qu’elle contient en puissance. Il y a donc à la fois rupture et continuité entre la doxa et la dialectique philosophique.
A ce titre, le philosophe est bien un « maitre de vérité », et non un « maitre de savoir » comme le sophiste.
Tout à fait : le cadre épistémologique est radicalement différent, d’abord parce que la philosophie pose, avec Platon, l’existence d’un absolu, l’eidos ou « Idée », que l’on identifie à ce que Parménide appelait l’alètheia (la vérité). Cet absolu étant posé, le cadre relativiste des sophistes est désamorcé.
Toutefois, je ne suis pas certain que nous puissions avancer que cette vérité est immanente. Son mode de dévoilement est effectivement immanent en ce qu’elle procède selon une méthode dialectique incarnée dans la relation maïeutique entre le maître et l’élève. Mais ce que le maître est en mesure de faire accoucher, c’est bien quelque chose qui n’entretient aucun espèce de commerce avec le monde sensible, en tant que cette chose est une Idée, c’est à dire précisément une « vérité en puissance ». La réminiscence de l’agent n’est pas un simple « ressouvenir » issu d’un passé physique, mais un ressouvenir issu du temps où l’âme « avait des ailes », c’est à dire habitait le monde intelligible. En ce sens, on peut faire état d’un saut qualitatif, une rupture ontologique de niveau qui peut nous faire dire que la méthode socratique est un procès permettant de cheminer, depuis le monde sensible, jusqu’aux vérités du monde intelligible que l’on doit poser comme transcendantes.
A moins que nous ne considérons, comme le vieux Platon, que puisque la vérité n’est pas accessible, qu’il vaut mieux se contenter de l’opinion vraie qui, il est vrai, habite plus certainement le monde sensible.