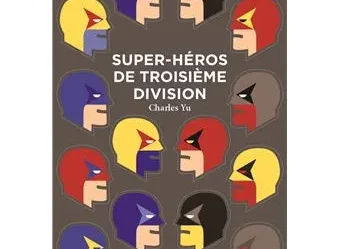Rodolphe Casso a vécu plusieurs vies, ou plusieurs morts, selon qu’on boit le verre à moitié vide ou à moitié plein : musicien, journaliste dans des sujets aussi variés que le rock, la cinéma, le jeu vidéo, l’urbanisme, il a publié aux Editions Critic les romans Pariz et Nécropolitains, où il imaginait Paris en proie à une apocalypse zombie. Récemment, il a sorti Le dernier jour du Tourbillon aux éditions Aux Forges de Vulcain, roman tout à fait réaliste cette fois dans lequel il raconte, pince-sans-rire, une journée dans un bar miteux dans un quartier gentrifié. Cet entretien nous donne l’opportunité de lui extorquer les secrets du remède à la gueule de bois, ou les mille et une astuces pour s’extirper de son siège après quelques shots. Ah, et d’évoquer, non pas la fin des temps, mais celle d’une époque.
[On rappellera au lecteur en état d’ébriété légère que le tenancier et responsable de cet entretien, Thomas Spok, est également publié chez les Forges de Vulcain, donc ne cherchez pas ici la moindre goutte d’objectivité, la moindre vapeur d’esprit critique. Mais d’abord, comme c’est la tournée de Rodolphe Casso, un extrait de son roman, en particulier de son incipit…]
Extrait de l’incipit :
Le Tourbillon est un bar « dans son jus ».
Ici, pas de déco imaginée par des architectes d’intérieur obsédés par les codes esthétiques de Brooklyn, pas de briques apparentes, pas de panneaux de lambris, pas de béton brut.
Oh que non.
Ici, le comptoir de bois laqué est parcouru de veines imitant grossièrement celles du marbre brun, le tout coiffé d’un zinc plus constellé d’impacts que la surface lunaire.
Au sol, un carrelage de casson se répand en mosaïque de cyan délavé, de gris pigmenté et de pourpre agonisant, support des va-et-vient de milliers de traîne-savates qui ont usé cette salle des pas perdus où le corps stationne tandis que l’esprit voyage.
Aux murs, des vedettes se disputent l’espace, idoles figées dans leur noir et blanc. Ici, il y a Gabin, Delon, Marais, Belmondo – le panache à la française. Là, il y a Marylin, James Dean, Elvis ou John Lennon – la mort prématurée à l’anglo-saxonne.
Ancré dans un plafond jaune cigarette, le ventilateur à trois pales aurait pu brasser l’air des demeures coloniales à l’époque où les frontières de la France s’étendaient jusqu’au delta du Mékong. Au lieu de cela, il dirige la poussière vers la ribambelle de bouteilles de sodas et de jus de fruits alignées derrière le comptoir comme des bibelots de grand-mère. Si quelqu’un époussetait leurs étiquettes, on découvrirait des marques retirées du commerce au siècle dernier. […]
Au Tourbillon, contrairement aux établissements en vogue qui justifient leurs additions prohibitives par d’ostensibles efforts de décoration, le café noir est à un euro tout rond au comptoir, l’arrière-goût âcre du percolateur mal nettoyé étant inclus. Du bec en inox de la tireuse jaillit une bière blonde de brasseur industriel stérilisée et non pas l’un de ces breuvages douteux issus de micro-brasseries utilisant des houblons d’origine exotique et des levures sorties d’un grimoire de sorcière. […]
Les mauvaises langues diront que la carte du Tourbillon est si bon marché, si tentatrice, que c’en est dangereux pour qui reprend le volant. Mais comme dans le quartier plus personne n’a de voiture depuis l’éradication des places de stationnement, l’aménagement d’une zone 30 et l’obligation de rouler propre les jours impairs et de pleine lune, le risque est désormais proche du zéro. Les habitués sont de toute façon des riverains circulant à pied – ou à quatre pattes après une certaine heure.

[Thomas Spok]– Après deux romans de zombies, comment en arrive-t-on au réalisme ?
[Rodolphe Casso] Je n’ai jamais eu la sensation d’avoir écrit des romans totalement « irréalistes ». Non pas que je croie que Paris puisse être envahi par des hordes de morts-vivants, mais disons que je suis parti d’un statut de départ réaliste qui veut que les Parisiens soient toujours décrits comme des zombies, parce qu’ils font la gueule, ont le teint pâle, grognent tout le temps… J’ai donc pris l’adage au pied de la lettre. Et ça m’a emmené vers un récit où, finalement, il est plus question de relations sociales en conditions extrêmes que de baston avec des goules. Dans PariZ, je fais cohabiter des clochards avec des néo-nazis et des militaires – paye ta testostérone. Dans Nécropolitains, mon héros, qui est militaire – encore – explore différentes communautés de survivants et découvre leurs modes de fonctionnement, allant de la société du spectacle à la théocratie, en passant par la démocratie participative… Au milieu de tout ça, dans ces deux romans,
le zombie est en fait l’habitant type de la capitale ; il fait partie du décor. Il est même chez lui, en fait. Beaucoup plus que mes personnages. Et il symbolise aussi le danger de l’extérieur, de l’autre, de l’altérité. Soit une bonne raison de se replier sur soi-même, ses habitudes et ses certitudes.
Tout ça pour dire que je n’ai jamais eu la sensation d’être un auteur de science-fiction à part entière. J’avais d’abord envoyé PariZ à des maisons d’éditions généralistes, d’ailleurs. Mais le marché de l’édition veut que dès le terme « zombie » apparait quelque part, le texte est automatiquement classé dans la catégorie « imaginaire / SF ». Donc je me suis tourné vers les Editions Critic, et c’était très bien comme ça. Parce que la SF fait partie de mes influences et que je suis aussi à l’aise dans cet univers. Mais pas que.
– Comment s’est passé le changement d’éditeur ?
Ça a pris du temps. Nécropolitains est sorti en octobre 2019. Puis est arrivé le covid en mars 2020. A ce moment-là, c’est le confinement et je me remets à écrire – comme tout le monde, tu vas me dire… Et ce que j’écris n’est clairement plus de la SF. Problème : les Editions Critic ne publient que de la SF et de la fantasy – et aussi un peu de thriller. Il me faut donc trouver un autre éditeur pour ce que j’ai en tête. J’avais commencé à échanger avec une éditrice, sans que ça aboutisse. En parallèle, j’avais en tête ce type très sympa qui avait une maison d’édition un peu spéciale, entre littérature généraliste et imaginaire : Aux Forges de Vulcain. En l’occurrence, David Meulemans. J’avais déjà rencontré David quelques fois lors d’événements littéraires, je savais qu’il avait aimé Nécropolitains, on échangeait un peu sur Facebook à base de blagues et de références geek 80’s / 90’s… Bref, avec du recul, on se reniflait sans doute déjà un peu le cul.
Et puis un jour, toujours pendant le confinement, je me dis que c’est vraiment une bonne piste. Parce que, à ma connaissance,
seul David [Meulemans] savait faire ce grand écart entre imaginaire et littérature générale. Il comprendrait sûrement là d’où je venais et où je voulais aller.
Donc je l’appelle pour lui dire que j’ai un texte à lui soumettre. Après une série d’échange, la signature se profile, à condition que je sois patient. Car, comme pour tout le monde, le covid a chamboulé son calendrier de sorties, tout est décalé. Et, de plus, il s’apprête à changer de structure. Bref, il me dit : « Si tu es prêt à attendre, on signe pour une sortie en 2023. » Je rappelle qu’on est alors à la fin du printemps 2020… Mais je n’étais pas pressé.
– Pour écrire un roman sur un bar PMU, il faut bien avoir un problème d’alcool, non ?
Alors, déjà, Le Tourbillon n’est pas un bar PMU, qui est une typologie d’établissement un peu différente. Dans le PMU, on est surtout là pour jouer et parier. Bien sûr, on picole aussi, mais ce n’est pas la finalité. La finalité, c’est de perdre le peu d’argent qu’on a – les clients ne sont clairement pas des rentiers. Le Tourbillon appartient à la catégorie des rades, des bars « dans son jus », des troquets d’habitués, des bistros de quartier. Il y a là une notion plus sociale, plus relationnelle que le simple fait de jouer. Quant à un supposé problème d’alcool pour écrire sur le sujet, je répondrais que, comme tout Français qui se respecte, je n’ai aucun problème avec l’alcool.
– Et donc « Le dernier jour du tourbillon » : comment le titre a-t-il été choisi ?
J’aime bien l’idée de dévoiler la fin dès le début. Ça n’enlève pas le suspens, ça le réoriente. Dans Nécropolitains, dès le début j’annonce que mon héros a pour mission de visiter trois quartiers dans un Paris ensauvagé. Le lecteur se doute bien qu’il va y arriver – sinon à quoi bon les énoncer ainsi ? Ce qu’il ne sait pas, c’est ce qu’il va découvrir à chaque destination ; c’est là que je ménage mes effets. Et dans Le dernier jour du Tourbillon, il est annoncé dès le titre que le bar vit ses derniers instants. Pourquoi ? Qui lira saura.
– Tu as été musicien. Comment en es-tu venu à la littérature ?
En me lançant dans la musique, c’est-à-dire en cherchant à me professionnaliser, j’avais conscience que le temps était compté. Il y a une règle immuable : on ne devient pas rock star à 40 ans. Dans 99% des cas, les gens qui percent dans la pop, le rock, le rap, la variété, ont entre 5 ans et 35 ans. Moi, entre 33 et 34 ans, j’ai vécu une série d’événements difficiles qui m’ont détourné de mes obsessions musicales. J’ai tout mis sur pause, et un poids s’est levé de mes épaules. J’ai compris que j’en avais plein le dos et que je n’allais pas reprendre. J’avais consacré sept ans à cette entreprise, j’avais refusé ou quitté des jobs pour conserver une liberté d’action et accorder autant de temps que possible à la musique, mais là, j’étais en train de perdre le mojo, et puis j’allais atteindre la date de péremption.
À cette période, j’écrivais pour un magazine de rock, qui n’a malheureusement pas duré bien longtemps, et je pondais chaque mois environ 25% du titre en rédactionnel. Certains mois, j’atteignais les 150.000 signes, entre articles, interviews et chroniques. Un pote écrivain m’a fait remarquer qu’en termes de volume, ce que j’avais produit dans l’année était l’équivalent d’un bon gros roman. Cette remarque m’a travaillé. Bien sûr, écrire des articles et produire un texte de fiction sont deux choses très différentes. Mais je sentais que cette cadence d’écriture, que je n’avais jamais atteinte auparavant et qui m’obligeait quand même à faire souvent appel à l’inspiration – parce que quand tu dois accoucher de trois pages sur un groupe que tu as découvert l’avant-veille, t’as intérêt à être inspiré –, ça m’avait donné confiance en ma capacité de production. C’est là que j’ai commencé à écrire PariZ. Et je me suis alors dit un truc qui m’a énormément réconforté :
si on ne devient pas rock star à 40 ans, on peut devenir écrivain et ce, jusqu’à sa mort.
– D’ailleurs le roman met en scène un groupe. Comment écrit-on la musique ?
Sans mélodie, c’est compliqué… En gros, vis-à-vis du lecteur, c’est comme faire avaler un plat à quelqu’un qui aurait perdu le goût. Il manque le sens principal. Alors il faut trouver des biais. Ce qu’il reste de musical avec l’écriture, c’est surtout le rythme. Alors il faut que ça enchaine, que ça déroule. Chez moi, ça consiste à alterner quelques vers de chanson avec quelques phrases de description, et ainsi de suite. Ça permet de mettre en perspective le texte de la chanson avec ce qui se passe dans la salle ou chez les personnages. Cette alternance crée un roulement qui simule, en quelque sorte, la musicalité.
Dans PariZ, j’avais utilisé une autre technique. La musique avait ici une importance tout autre : c’était une arme. Deux personnages s’en servent pour attirer les zombies dans un piège à l’aide d’un iPod et d’une enceinte longue portée. Faute de mélodie là encore, j’ai pris le parti de citer des bouts de chansons archi-connues. Comme ça, je savais que le lecteur les aurait forcément dans la tête en lisant. Tiens, faisons le texte avec tes lecteurs, Thomas :
Si je dis Aux Champs-Elysées de Joe Dassin…
Si je dis Je marche seul de Jean-Jacques Goldman…
Si je dis Allumer le feu de Johny Hallyday…
Ma main à couper que celles et ceux qui sont en train de lire ces lignes ont les mélodies en tête. Et peut-être envie de me buter.
– Et les chansons citées dans le roman ?
Il y a deux types de chansons dans Le Tourbillon. Tout d’abord, les « vraies », celles qui sont signées par des gens connus : Gainsbourg, Brel, Aznavour, Vian, etc. Et puis celles que j’ai écrites moi-même. Il y en a trois dans ce cas. Deux sont jouées pendant la séquence du concert. Ce sont des chansons que j’ai moi-même jouées sur scène par le passé. Et la troisième, totalement débile, passe à la radio pendant un moment de grosse teuf dans le bar.
– Qu’est-ce qu’un rade ?
Le mot « rade » désigne un refuge pour les bateaux, un site naturel à l’abri du tumulte de la haute mer. C’est un lieu propice au repos. On y imagine des navires en réparation, et des marins en permission qui en profitent pour se souler la gueule. On bien des pirates dans une crique secrète venus enterrer un trésor… et se souler la gueule.
Le Tourbillon est un rade dans le sens où il accueille des épaves de la vie, des pirates aussi.
Des gens qui ne veulent pas jouer le jeu du monde extérieur, de sa course au progrès et à la modernité, parce que trop fragiles, trop usés ou trop en décalage.
Comment fais-tu d’un lieu, le personnage principal ?
En le rendant attachant aux yeux des gens. J’y ai disséminé de nombreux objets que tout le monde connaît, et qui peuvent même avoir un effet « madeleine ». Et puis j’en parle comme s’il était vivant : Le Tourbillon ralentit, accélère, s’arrête, vibre… J’use beaucoup de cet effet.
– C’est quoi, le pilier de comptoir ? Et la symbolique du Get27 ?
Le pilier de comptoir, c’est le mec qui tient les murs, quoi. Parce qu’il est tout le temps là. Presque plus souvent que le taulier. Tu arrives, il est déjà là. Tu pars, il est encore là. Comme il est dit dans l’une des chansons du roman :
« T’as tellement trainé dans ce bar que c’est plus des additions que tu paies, c’est un loyer ».
Quant au Get 27, c’est la menthe à l’eau des grands enfants. Un truc régressif, trop sucré, trop coloré, hyper sirupeux, poisseux… Ça relève de l’immaturité.
– Et le bon taulier ?
Pour faire la promotion du roman avant sa sortie, j’ai tourné des interviews de tauliers dans les bars que j’aime bien (tu seras mignon de produire les liens Youtube, histoire de faire quelques vues supplémentaires), et le principal enseignement de ces entretiens, c’est que l’âme d’un lieu, c’est son tenancier ou sa tenancière.
C’est aussi simple que ça. Donc un bon taulier, c’est quelqu’un qui a une forte personnalité, qui a du répondant, qui sait écouter, qui rend service aux gens du quartier, qui a le geste commercial au bon moment, avec qui on peut parler de l’actualité, avec qui on se marre… C’est le pote que tu es sûr de trouver à toute heure de la journée, toujours au même endroit. Qui est plus fiable que ça ?
– Ton roman serait une machine à remonter dans le temps ?
Je ne pense pas que ce soit ça. Ce genre de bars existe encore si on cherche un peu.
– Pour autant, est-il nostalgique ?
Moins qu’il n’y paraît. La nostalgie ne doit pas empêcher d’aller de l’avant. Parce que le mouvement, c’est la survie – on apprend ça dans les histoires de zombie. La stagnation, c’est la mort au coin du feu. Et puis il y a aussi un propos sur la modernité : y résister, c’est risquer d’être balayé.
Pourquoi les bars disparaissent-ils ?
Les chiffres parlent d’eux-mêmes. En 1900, on avait 500.000 bars et restaurants en France. Dans les années 1960, on est passé à 200.000 et aujourd’hui ça doit être entre 30.000 et 40.000. Les gens ont plein de trucs chez eux, au 21e siècle : les machines Nespresso, la télévision, la fibre, les consoles de jeu, les plateformes, le télétravail, la livraison à domicile, les applications de rencontres… Il faut dire que, sur le papier, rien n’est moins utile qu’un bar. On y trouve des choses qu’on a tous chez soi : des tables, des chaises et des boissons vendues trois fois plus cher qu’au supermarché. Donc à quoi bon, hein ? Et pourtant… ça attire encore des gens. Comme lieu de rendez-vous, de paraître, de rencontre, de repos, d’évasion, de travail, de lecture…
Quand tout ça aura disparu, ça fera comme quand le service public a arrêté la diffusion de Bouillon de Culture, l’émission littéraire de Bernard Pivot. Tout le monde avait dit « oh ben merde, c’est dommage. » sauf que ceux qui disaient ça ne regardaient jamais.
– En fait, ce serait un roman sur la gentrification ?
Ce n’est pas le propos mais c’est la toile de fond. Le Tourbillon est le dernier bar un peu « roots » dans un quartier en pleine gentrification, où poussent des nouveaux lieux inspirés par les commerces de Brooklyn ou Berlin… Il est comme un village de Gaulois cerné par les camps romains. Sauf que quand la potion magique est à base de Get 27 ou d’Amstel, tu vas pas bien loin sur le champ de bataille…
– Pourquoi Gus ? S’agit-il du parasite par excellence ? Pour autant, il n’est pas totalement antipathique…
J’aime bien l’idée du personnage qu’on ne va pas aimer tout de suite. Qu’on va apprendre à aimer. Gus est un parasite, certes, mais un gentil. Il est surtout très naïf, parfois un peu benêt. Il refuse d’aller de l’avant.
C’est le genre à croire qu’il peut devenir rock star à 40 ans passés.
– Donc, il y a un bar. Mais dans quelle ville ? Où se passe le roman, finalement ?
Le Tourbillon se situe dans une grande ville. Je ne la nomme jamais. Et le peu de nom de rues que je cite sont totalement génériques : rue Jean-Jaurès, rue Garibaldi… Et démerdez-vous avec ça.
– Comment le lecteur devient-il un peu un personnage, lui aussi ?
Parce qu’au fond de lui, il sait qu’il ne vaut pas mieux que les clients du Tourbillon.
– C’est quoi l’amitié, dans un rade ?
C’est de s’écouter et de s’offrir des verres. Mais la véritable amitié commence quand on se voit en dehors du bar. Autrement, ce n’est pas de l’amitié, c’est de l’habitude.
– Comment écrit-on un huis-clos ?
En faisant court, rythmé, et en dosant le nombre de personnages, leurs profils et leurs interactions. Ce dernier point implique aussi de maîtriser les dialogues. C’est ce que je préfère. Pour moi, écrire des dialogues après une longue description, c’est la récréation. Sans doute parce que
les dialogues, c’est un peu de la musique.
– Comment lire l’addition ?
Si tu lis l’addition, c’est qu’elle est dans tes mains, et c’est donc toi qui paies. La question serait plutôt : comment ne pas lire l’addition.
– Comment sort-on d’un rade, d’un huis clos ?
Tout ce que je peux dire, c’est que lorsqu’on entre dans un tourbillon, on n’en ressort que par le bas.
– Mais, quelles sont les meilleures raisons de ne pas sortir d’un rade ?
Parce qu’il fait froid dehors et que le monde est cruel.
Taulier, la petite sœur !