
Que faire de son temps ? Comment en dépenser les minutes, les heures et les jours que l’on sait si précieux ? Faut-il agir, se déployer intégralement, jusqu’à épuiser, vider, siphonner tout ce que la fortune garde en ses greniers ? Ou vaut-il encore mieux ne rien faire, ou si peu, allongé dans un divan confortable, à l’abri, léger de voir les hommes cramoisis d’action, sauter comme des puces, comme se débattant au prix de mille efforts contre un repos qu’ils ne savent apprécier ? Ilya Ilitch Oblomov a son idée là-dessus, et elle vaut le détour.
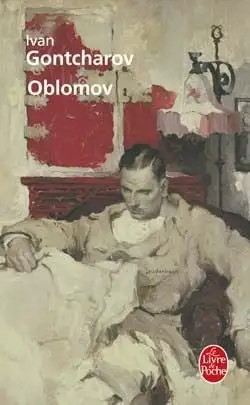
Oblomov – Gontcharov
Ilya Ilitch Oblomov, c’est le personnage d’un classique de la littérature russe : Oblomov d’Ivan Gontcharov. Curieusement assez peu connu en France, il s’agit pourtant d’un livre rare, car il est de ces livres qui labourent, exhument de la glaise des questions enterrées en douce par notre inconscient, et tout cela, l’air de rien, comme en passant, dans l’aigre-doux du souffle poétique génial qui porte la mince intrigue du livre : Ilya Ilitch Oblomov, petit seigneur russe de la fin du XIXe siècle, cultive l’art de ne rien faire, confortablement installé dans le divan de son appartement de Saint-Pétersbourg. Prince de la procrastination, maître du « mañana », héros de l’assoupissement du dimanche après-midi, Oblomov a choisi : il ne veut rien faire. Ça tombe bien, il ne peut rien faire non plus.
Ilya Ilitch Oblomov ne veut rien faire donc. Sur sa table, il y a des restes du repas de la veille ou même de Dieu sait quand. Sous l’assiette, il y a des courriers urgents, du genre de ceux qui concernent les (mauvaises) affaires de sa seigneurie. Il faudrait s’en occuper, prendre des décisions, puis écrire, et vite. Quelle histoire ! Quelle angoisse ! Et quel beau temps il fait ! Quelle idée ce serait de gâcher une si belle journée avec de tels tracas. Mais voilà qu’on le presse :
« — Écrivez tout de suite.
— Tout de suite ! Tout de suite ! Comme si je n’avais pas d’affaires plus importantes à régler ! Et puis regarde, il n’y a plus d’encre là-dedans dit Oblomov, tournant sa plume sèche dans l’encrier vide. Alors, comment veux-tu que j’écrive ? […] Il semble bien qu’il n’y ait même pas de papier ! se dit-il, fouillant dans le tiroir et tâtant des objets posés sur la table. Non décidément, il n’y en a pas. Ah, c’est parfait, parfait ! (1) »
Alors non, vraiment, ce sera pour demain. Peut-être. Et voilà Zakhar le serviteur qui entre dans la pièce. Lui aussi, il est intime avec l’oblomovisme, la maladie d’Ilya qui consiste à vouloir ne rien faire. Balayer le plancher ? Eh ! À quoi bon ? Avec la poussière c’est toujours pareil, le combat est vain : « si on balaye, il s’en accumulera d’autres, et demain ce sera pareil ». Ça va quoi, y a pas marqué Sisyphe ! Et les punaises sur le lit, sur le divan, partout ? « Est-ce ma faute s’il y a des punaises dans le monde ? Est-ce moi qui les inventées ? » Et le serviteur de soupirer, tout en se soustrayant malicieusement à l’ouvrage : « Ce n’est pas une vie ! J’aimerais mieux que Dieu rappelle mon âme ! » (2).
Sage comme Oblomov
La première (très drôle) partie d’Oblomov décrit ainsi par le menu toutes les curieuses habitudes d’Ilya et de son serviteur. Pour un peu, leur paresse passe même pour une forme de sagesse, un « Non » ferme face aux mondanités superficielles de l’époque. Ilya ne fait rien certes, mais est-ce que les autres font ? Et lorsqu’ils font, font-ils bien ? L’ignoble Tarantiev, qui visite parfois Oblomov, le montre bien : on peut agir, s’engager dans la vie au grand galop et être un parfait salaud. Ilya lui, est une oie blanche, puisqu’il ne fait rien.
Lucrèce, dans le célèbre chant II de son De Rerum Natura, explique d’ailleurs que le bonheur absolu est celui qui consiste à voir depuis la terre un navire pris dans la tempête, « non que la souffrance de quiconque soit doux plaisir ; mais apprécier la distance des maux dont on est soi-même à l’écart est suave » (3). Qui peut alors mieux comprendre l’invitation épicurienne de Lucrèce qu’Oblomov-sur-le-divan ? N’est-il pas lui aussi suave contemplant des tempêtes auxquelles il est soustrait ? Si nous entendons comme les philosophes du Jardin que le bonheur est avant tout une absence de douleur (ataraxia), alors Oblomov est vraisemblablement heureux.

Car Ilya l’a bien compris : l’essentiel est d’éviter le souci et la souffrance. Ainsi, vidé de toute ardeur, Oblomov est encore sans désir : même l’amour pour la belle Olga, dont la vitalité déclose rayonne dans tout le livre, ne peut réveiller le feu de sa volonté. Ilya l’aimera, mais l’oblomovisme sera trop fort. Aimer, c’est inévitablement s’engager, se risquer, se fatiguer. Et puis, il y aura la passion. À quoi bon se jeter volontairement dans une telle tempête ? Ilya Ilich Oblomov, c’est celui qui refuse de se laisser emporter dans un engrenage qui le mènera vers Dieu-sait-quoi, car il le sait, il y aura, fatalement, de la souffrance.
En niant ainsi sa propre volonté, Ilya réalise peut-être le tour de force dont rêve Schopenhauer : celui d’échapper enfin au servage du désir par une connaissance simple et pure des choses devenant alors « quiétif de la volonté » (4). Dit autrement : je sais que le désir me projette dans toutes les directions et me suspend à son caprice ; la seule chose que je puisse faire pour reprendre le contrôle de ma vie, c’est d’abolir absolument tout désir. Alors survient le sage, l’ascète, le saint, celui qui accède au nirvâna l’air de rien, car son ego est dissout depuis longtemps : voilà Ilya Ilich Oblomov !
Mais voilà que je prostitue déjà le livre de Gontcharov pour servir mon petit bavardage. Il faut le dire, j’exagère un peu : Ilya désire, Ilya veut. Mais son désir prend la forme d’un « long dimanche après-midi en province » (5). Ce qu’il veut, c’est le repos. Pour lui, pour les autres. Lorsqu’il dort, et cela arrive souvent, Ilya rêve. La plupart du temps, il songe à l’Oblomovka, son domaine, qui dort dans quelque Russie intemporelle, imperméable aux « choses de la ville » :
« Où sommes-nous ? Dans quel coin béni du monde nous a conduits le rêve d’Oblomov ? En tout cas dans une région merveilleuse. On n’y trouve, il est vrai, ni mers ni montagnes, ni rochers ni précipices, ni forêts profondes ; bref on n’y trouve rien de grandiose, ni de sauvage, ni de terrible. D’ailleurs, à quoi bon le grandiose et le sauvage ? (6) »
Les hommes qui vivent là sont des paysans tranquilles, qui sifflent en tirant leur charrette. Quand le maître n’est pas là, ils font un petit somme après le repas (7). C’est de bonne guerre.
En somme, à Oblomovka, minéraux, végétaux, animaux et humains, tout est atteint d’oblomovisme. Tout conspire (soupire peut-être) à une vie lente, cyclique, sans heurts et sans désir autre que de persister dans son être. Oblomovka est la peinture caricaturale d’un village de carte postale. Mais, à y regarder de plus près, ne peut-on pas y voir, comme l’image d’une société parfaite en ce qu’elle aurait atteint un degré d’harmonie telle, qu’elle pourrait se contenter d’être sans jamais devenir ? La campagne tranquille d’Oblomovka, toute mariée à une éternité bucolique, où chaque chose est à sa place et où rien ne menace l’équilibre de la communauté, ne participe-t-elle pas d’une certaine façon à la République dont parle Platon ?
En effet, la République de Platon, entendue comme une société idéale, dispose de caractéristiques propres sur lesquelles tout le monde a beaucoup glosé en oubliant parfois le principal : la République est ceci et cela car tout doit conspirer à l’établissement d’un équilibre absolu et immuable qui doit contredire la contingence du devenir des sociétés boiteuses. La République est et jamais elle ne doit devenir, car si elle change, c’est qu’elle n’est pas conforme à un modèle absolu, à une Idée (8). Or, force est de constater qu’Oblomovka ne change pas et demeure toujours conforme à son Idée. Alors, tenons-nous là une société idéale, imaginé par quelque « Platon en robe de chambre » (9) ?
Déjà je le devine, le lecteur se révolte et proteste : Oblomov ne peut avoir raison, parce que la vie dont il rêve et qu’il met en pratique n’est pas une vie, du moins pas une « vraie vie ». Alors, qu’est-ce qui ne va pas ? D’où vient ce sentiment naturel qui nous pousse à refuser catégoriquement la proposition oblomovienne ?
Malade comme Oblomov
Ilya est un fainéant vétéran, certes, mais il ne l’est pas naturellement, entendons par là qu’Ilya Ilich Oblomov, petit seigneur russe, aurait pu être autrement. Ce que nous laisse entrevoir Ivan Gontcharov dans sa description du personnage, c’est un homme moyen, relativement capable de mener une vie bien comme il faut dans le microcosme mondain pétersbourgeois, et même au-delà. Doté d’une fortune modeste mais suffisante pour se dispenser de travailler et d’une intelligence convenable, Ilya peut même séduire. Après tout, n’a-t-il pas charmé Olga ? Mais lorsqu’il la laisse partir, tétanisé devant l’ampleur que pourrait prendre sa vie, pour mieux lui préférer la vulgaire mais tranquille Agafia Matveïevna dont le seul charme réside dans les cercles rapides que font ses coudes lorsqu’elle tourne le moulin à café (10), Ivan Gontcharov oblige son lecteur à sentir le gâchis grotesque qu’implique l’oblomovisme.
Car ce que fait Ilya, ce n’est rien d’autre que de laisser dormir sa puissance sans jamais l’actualiser, c’est engourdir jusqu’à l’étouffement sa capacité de se déployer. En des termes aristotéliciens, c’est refuser de faire de sa vie l’entéléchie de son existence, c’est-à-dire de faire un profit maximal des potentialités contenues dans son être (11). Dit autrement : c’est se gâcher. Et puisque nous sommes entrés en sympathie avec Ilya, ce gâchis nous est insupportable.

Comme nous l’avons dit plus haut, Oblomov a mortifié sa volonté jusqu’à l’abolir presque intégralement. Il échappe ainsi à la souffrance, mais il échappe également au bonheur, si nous le comprenons comme une positivité, ainsi que le concevaient les philosophes anciens. Après tout, il s’agit là d’un fait qui nous semble intuitif : le bonheur ne peut consister dans une neutralisation du monde, mais au contraire dans une affirmation, un élan, une action (12). Je suis heureux car je suis vertueux disent les stoïciens ; car j’ai constamment commerce avec le plaisir disent les Cyrénaïques ; car je suis conforme à la Nature disent les Cyniques ; car je m’approche de la vérité par la science disent les Académiciens. Bref, je suis heureux car je fais. Or, puisqu’Ilya ne fait rien, il nous semble inconcevable de l’admettre sincèrement heureux.
Là est toute la philosophie d’Ilya Ilitch Oblomov : renoncer au risque, à la grandeur, à l’ambition. Tout sacrifier à la sécurité, la tranquillité, le repos. Ilya a préféré la maladie à la santé et c’est pourquoi il nous est difficile de le suivre, comme tous ceux qui ont construit leur philosophie autour d’un principe vital (le conatus de Spinoza, la volonté de puissance de Nietzsche, l’élan vital de Bergson). Tous postulent l’existence d’une force, sentie par l’intuition, d’un principe d’action et d’affirmation, auquel il faudrait souscrire pleinement, en accepter absolument les soubresauts. Le personnage de Stolz, le seul ami d’Ilya, se situe précisément dans cet axe : il travaille, voyage de par l’Europe entière, et finit, évidemment, par partir avec Olga.
À l’inverse, ceux qui, comme Oblomov, réfrènent cette pente naturelle, ne peuvent que vivre dans les tourments d’une existence dévitalisée. Ilya est donc le « Dernier homme » dont parle Nietzsche dans le Zarathoustra, celui qui, bovin, cligne des yeux du bonheur de vivre longtemps tranquille, l’homme de basse intensité (13). L’oblomovisme est une maladie dégénérative et Ilya en est atteint. Il finira par mourir d’apoplexie, sans douleur, sur son canapé, « comme s’arrête une montre qu’on aurait oublié de remonter » (14). En écrivant cela, Ivan Gontcharov nous amène à ainsi considérer une autre pente naturelle de nos désirs : celui d’arriver, c’est-à-dire celui de se croire autorisé à se retirer des turpitudes.
Génial comme Gontcharov
Si Ivan Gontcharov ne prend pas clairement position dans cette querelle philosophique (l’intrigue semble aller contre lui, mais les arguments d’Oblomov restent toujours assez pénétrants), l’auteur vient cependant jeter un trouble dans la quiétude du lecteur, car nous savons qu’en nous loge forcément un petit Oblomov : celui qui incline à ne rien faire, à se reposer, à remettre au lendemain. Celui-là guette et attend son heure. Et peut-être que si nous n’y faisons pas attention, il risque d’étendre peu à peu son empire sur nos consciences. Alors nous nous réveillerons atteints d’oblomovisme. Mais sera-ce forcément un mal ?
Notes
(1) Gontcharov, Oblomov, Gallimard, Paris, 2007, p. 125.
(2) Ibid., p. 41.
(3) Lucrèce, La Nature des choses, Gallimard, Paris, 2010, p. 93.
(4) Schopenhauer, Le monde comme volonté et représentation, Gallimard, Paris, 2009, p. 729.
(5) La formule, tirée du Précis de décomposition d’Emil Cioran est même pensée par celui-ci comme un état à atteindre.
(6) Gontcharov, op. cit., p. 147.
(7) Ibid., 172.
(8) C’est le point capital du Livre IV de La République, Flammarion, Paris, 2002.
(9) Gontcharov, op. cit., p. 525.
(10) Ibid., p. 385.
(11) Pour comprendre un peu Aristote, c’est là.
(12) C’est ce qu’explique assez clairement Cicéron dans le Livre II de ses Fins des biens et des maux, Flammarion, Paris, 2016.
(13) Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra, LGF, Paris, 1983, p. 26.
(14) Gontcharov, op. cit., p. 538.


