
William Morris (1834-1896), connu notamment pour ses liens avec les artistes préraphaélites et le mouvement Arts and Crafts, écrivain qui a contribué à la fondation de la fantasy moderne, est aussi une figure du courant socialiste et libertaire en Angleterre. Son œuvre est progressivement rendue disponible en France grâce aux éditions Aux Forges de Vulcain (des amis). Il publie en particulier son roman News from Nowhere (Nouvelles de nulle part), en 1890, où il mêle science-fiction et socialisme utopique, qui connaît un certain écho en France.
Mais dans son propre camp, la chose n’est pas neuve, les disputes vont bon train. En 1884, Morris quitte ainsi la Social Democratic Federation pour fonder la Socialist League, qui se veut opposée à l’impérialisme britannique et rejette le parlementarisme. Il devient alors le financier et le rédacteur en chef du journal de la League, le Commonweal, qui commence à être publié en février 1885.

Le recueil de poèmes Pilgrims of Hope
Le 2 mars 1885, il y publie le premier chapitre de son recueil de poèmes Pilgrims of Hope (littéralement « Pèlerins de l’espoir »), dont le treizième et dernier chapitre est publié le 3 juillet 1886. Il s’agit d’un ensemble cohérent de poèmes narratifs sur le thème de la Commune de Paris. Son objectif est de rapporter l’histoire du mouvement socialiste récent et de proposer sa vision de l’héritage de la Commune.
Le recueil se veut expérimental, tendant au roman versifié, d’où d’ailleurs la répartition en chapitres : les rimes sont suivies, le vers long, la narration à la première personne alterne des considérations personnelles avec des considérations politiques qui cherchent à dresser un bilan de la Commune : une défaite pour les socialistes qui doit fournir un certain nombre d’enseignements.
L’universitaire Florence Boos constate au sujet du recueil qu’il « est le seul long poème anglais de cette époque qui expose des idées et des conflits politiques d’un point de vue socialiste ou communiste, quel qu’il soit ».
J’en propose ci-dessous la traduction personnelle du chapitre 12 (juin 1886), « Meeting the War-Machine », traduction assez brute dans la mesure où je n’ai pas essayé de restituer un mètre ou des rimes, privilégiant ici le narratif. Le lecteur pourra relever ici et là des archaïsmes, dont Morris était féru. Des corrections auront sans doute lieu. J’inclus également à la suite le texte anglais.
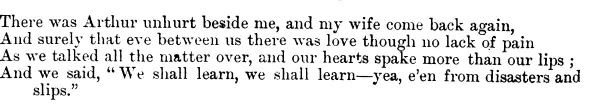
Contexte
Le narrateur, Richard, est un jeune charpentier, bientôt au chômage, qui partage avec sa femme (anonyme) des idéaux socialistes. Ils ont un enfant. Richard milite, se fait arrêter. Après sa libération, il part avec sa femme et son ami Arthur pour participer à la Commune de Paris. Ils connaissent les horreurs du siège et du feu d’artillerie. La femme de Richard et Arthur tombent amoureux, mais rien ne semble pouvoir entamer les liens et les idéaux du trio…

12. Face à la machine de guerre
Dans la cité assiégée ainsi nous demeurâmes, à part entière un fragment de sa vie.
Y songeant à présent depuis l’Angleterre, moi qui ne suis qu’un atome dans la lutte,
Je puis voir que j’ai peut-être assisté au début de ce que serait la fin du monde,
L’espoir de l’homme dévoré au temps où les Dieux ont soif.
Mais, comme je vous le disais, nous vivions en ces jours une vie qui n’était pas la nôtre ;
Et nous ne vîmes que l’espoir du monde, la graine semée par les âges,
Et le bel arbre en fleur engendré soudain de la terre qui recouvrait les morts ;
La terre diligente, la terre levée en marée de vive-eau, exaltée par le sang répandu de ses amants,
Par les jours heureux défaits pour le bien de son jour de bonheur à elle,
Par l’amour des femmes de jadis, et la splendeur de la jeunesse consumée,
Par la douceur dépouillée des vies précipitées dans les remous de la guerre,
Par l’espérance du cœur endurci qui s’épuise au loin, pour toujours.
Ô terre, terre, veille sur tes amants, qui connaissaient tous tes bienfaits et tes dons,
Mais s’en débarrassèrent pour ton bien, pour s’emparer d’une douleur aride !
En vérité, prends soin de certains d’entre eux, n’oublie jamais leur histoire,
Jusqu’à ce que diminue le flot de tes océans, que ton soleil prenne la teinte pâle de la cire.
Souviens-toi plutôt, je te prie, de ceux-là qui, aux derniers jours,
Ne furent rassasiés d’aucune belle promesse ni enivrés d’aucun éloge.
Pour eux, il n’y eut pas de cieux grands ouverts pour tendre la couronne du martyre ;
Nul peuple délivré ne les pleura, nulle moisson de gloire
Ne fut par eux fauchée dans la bataille ; il n’y eut pas, près de leur lit de mort,
La bénédiction qu’épanchent en douce rosée les adieux d’amis rassemblés ;
Dans les ruelles sordides de la cité, parmi un peuple qui ne les connaissait pas,
Dans la mort vivante du cachot, en effet, tu leur fis un sort,
Et pourtant tu leur trouvas des œuvres à accomplir ; ils n’étaient pas de la valetaille
Pour s’irriter de leur propre déconfiture et se lamenter pour le reste de leurs jours ;
Ils se montraient souvent plaisants et joyeux, adroits à extorquer de la lutte
Une part de gaieté, que d’autres ne trouvent pas lors d’une randonnée paisible.
Ainsi se débrouillaient-ils, toujours démunis, sans solliciter l’aide de la fortune.
Leur vie fut ta délivrance, Ô terre, c’est pour toi qu’ils luttèrent ;
Parmi les railleries des bienheureux et des désœuvrés, parmi les amis tombés, ils allèrent
À leur perte funeste mais féconde, par amour de ta volonté.
Oui-da, nous y prîmes notre part, à ce début de la fin,
À ce premier combat de la bataille suprême d’où toutes les nations découlèrent ;
Or, vous en ferais-je le récit, vous pourriez la juger modeste et médiocre.
Car peu d’entre vous penseront au jour qui eût pu advenir,
Et encore moins, ce me semble, au jour qui pourrait venir,
Qui mettrait en lumière ce commencement, et le malheur qui lui est entremêlé.
La guerre en effet est bien une machine que mènent les hommes ;
Et nous ne contrôlons pas sa manivelle, nous les dupes de notre héritage,
Nous les travailleurs rendus esclaves des machines. Oui, elle nous réduisit à peau de chagrin,
Cette machine des Bourgeois usés ; bien que souvent le labeur fût rude
Pour ce qu’il rapportait. D’abord, comme d’autres jeunes soldats
Je connaissais à peine les raisons pour lesquelles notre camp avait subi le pire ;
Car dans la mêlée, le ventre noué, nous avions bel et bien fait face ;
Et je me disais, demain ou le jour suivant, ce sera une autre histoire.
J’étais ardent, sans peur ; pourtant, comme ils étaient beaux les coteaux boisés,
Les fermettes et les jardins ensoleillés, malgré la mort que recelait leur sein !
Ils sont peu nombreux et bien fous, ceux qui volontiers laissent derrière eux le monde,
Et l’histoire bel et bien achevée, la fin de la vie et de la lumière.
Tu ignores toute haine de la vie, Ô terre, au milieu des balles que j’endurais,
Même si la douleur et le chagrin m’accablèrent tant que, peut-être, je n’en supporterai pas plus.
Mais en ces jours passés, la vie et la mort semblaient même chose ;
Oui-da, nous avions touché à la vie qui ne serait jamais défaite.
Vous voudriez que je parle des combats ? Oh, vous savez, c’était nouveau pour moi,
Bientôt pourtant il sembla que cela avait toujours été ainsi, et le serait toujours.
Le matin où nous fîmes notre sortie, certains crurent (mais pas moi)
Que dans quelques jours, tout serait fini ; quelques-uns seulement auraient eu à mourir,
Le reste dès lors vivrait heureux. Or mon sang de campagnard borné
M’incitait à retenir mon hallali jusqu’à ce que nous soyons sorti du bois.
C’est pour cette raison peut-être que je ne fus guère découragé,
Comme nous nous tenions blottis les uns contre les autres, cette nuit-là, masse impuissante,
Ainsi que font d’ordinaire les hommes : et je savais assez de la guerre
Pour comprendre quelles sont trop souvent les erreurs parmi ses œuvres maladroites.
Arthur indemne se trouvait à mes côtés, ma femme revint,
Et bien sûr ce soir-là il y eut entre nous de l’amour, quoique non sans douleur
Comme nous discutions de toute l’affaire à cœur ouvert, plutôt qu’avec nos lèvres ;
Et nous déclarâmes : « Nous apprendrons, nous apprendrons — oui-da, même des désastres et des faux pas. »
Voilà, nous apprîmes bien des choses, mais pas à prévaloir
Sur la brutalité de la machine de guerre, l’impitoyable meule à grains ;
Elle fut conçue par le monde bourgeois, pour le monde bourgeois ; et nous,
Nous étions pareil au tisseur du village en lutte contre le métier à tisser mécanique, peut-être.
Elle approchait de plus en plus, et nous commençâmes à guetter la fin —
Nous trois, du moins — et nos vies commencèrent à se combiner à la mort ;
Cependant notre agonie dura — cependant je demeure encore, tel un fantôme
Dans le pays où jadis nous fûmes heureux, pour veiller sur les êtres chers et les disparus.

MEETING THE WAR-MACHINE
So we dwelt in the war-girdled city as a very part of its life.
Looking back at it all from England, I an atom of the strife,
I can see that I might have seen what the end would be from the first,
The hope of man devoured in the day when the Gods are athirst.
But those days we lived, as I tell you, a life that was not our own;
And we saw but the hope of the world, and the seed that the ages had sown,
Spring up now a fair-blossomed tree from the earth lying over the dead;
Earth quickened, earth kindled to spring-tide with the blood that her lovers have shed,
With the happy days cast off for the sake of her happy day,
With the love of women foregone, and the bright youth worn away,
With the gentleness stripped from the lives thrust into the jostle of war,
With the hope of the hardy heart forever dwindling afar.
O Earth, Earth, look on thy lovers, who knew all thy gifts and thy gain,
But cast them aside for thy sake, and caught up barren pain!
Indeed of some art thou mindful, and ne’er shalt forget their tale,
Till shrunk are the floods of thine ocean and thy sun is waxen pale.
But rather I bid thee remember e’en these of the latter days,
Who were fed by no fair promise and made drunken by no praise.
For them no opening heaven reached out the martyr’s crown;
No folk delivered wept them, and no harvest of renown
They reaped with the scythe of battle; nor round their dying bed
Did kindly friendly farewell the dew of blessing shed;
In the sordid streets of the city mid a folk that knew them not,
In the living death of the prison didst thou deal them out their lot,
Yet foundest them deeds to be doing; and no feeble folk were they
To scowl on their own undoing and wail their lives away;
But oft were they blithe and merry and deft from the strife to wring
Some joy that others gained not midst their peaceful wayfaring.
So fared they, giftless ever, and no help of fortune sought.
Their life was thy deliverance, O Earth, and for thee they fought;
Mid the jeers of the happy and deedless, mid failing friends they went
To their foredoomed fruitful ending on the love of thee intent.
Yea and we were a part of it all, the beginning of the end,
That first fight of the uttermost battle whither all the nations wend;
And yet could I tell you its story, you might think it little and mean.
For few of you now will be thinking of the day that might have been,
And fewer still meseemeth of the day that yet shall be,
That shall light up that first beginning and its tangled misery.
For indeed a very machine is the war that now men wage;
Nor have we hold of its handle, we gulled of our heritage,
We workmen slaves of machines. Well, it ground us small enough
This machine of the beaten Bourgeois; though oft the work was rough
That it turned out for its money. Like other young soldiers at first
I scarcely knew the wherefore why our side had had the worst;
For man to man and in knots we faced the matter well;
And I thought, well to-morrow or next day a new tale will be to tell.
I was fierce and not afraid; yet O were the wood-sides fair,
And the crofts and the sunny gardens, though death they harboured there!
And few but fools are fain of leaving the world outright,
And the story over and done, and an end of the life and the light.
No hatred of life, thou knowest, O Earth, mid the bullets I bore,
Though pain and grief oppressed me that I never may suffer more.
But in those days past over did life and death seem one;
Yea the life had we attained to which could never be undone.
You would have me tell of the fighting? Well, you know it was new to me,
Yet it soon seemed as if it had been for ever, and ever would be.
The morn when we made that sally, some thought (and yet not I)
That a few days and all would be over: just a few had got to die,
And the rest would be happy thenceforward. But my stubborn country blood
Was bidding me hold my halloo till we were out of the wood.
And that was the reason perhaps why little disheartened I was,
As we stood all huddled together that night in a helpless mass,
As beaten men are wont: and I knew enough of war
To know midst its unskilled labour what slips full often are.
There was Arthur unhurt beside me, and my wife come back again,
And surely that eve between us there was love though no lack of pain
As we talked all the matter over, and our hearts spake more than our lips;
And we said, « We shall learn, we shall learn–yea, e’en from disasters and slips. »
Well, many a thing we learned, but we learned not how to prevail
O’er the brutal war-machine, the ruthless grinder of bale;
By the bourgeois world it was made, for the bourgeois world; and we,
We were e’en as the village weaver ‘gainst the power-loom, maybe.
It drew on nearer and nearer, and we ‘gan to look to the end –
We three, at least–and our lives began with death to blend;
Though we were long a-dying–though I dwell on yet as a ghost
In the land where we once were happy, to look on the loved and the lost.


